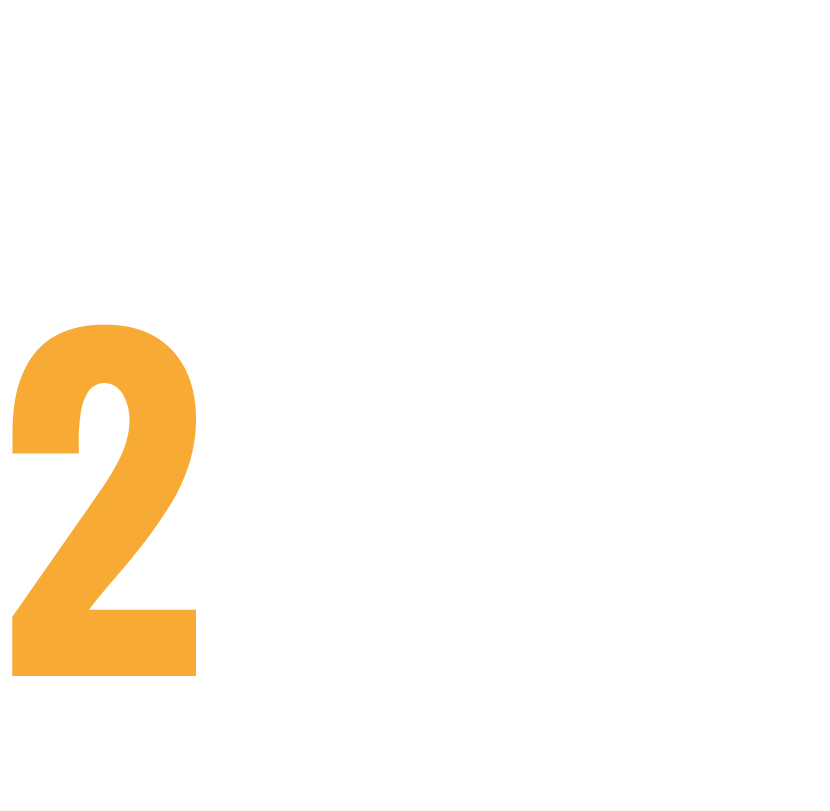Expositions (total : 7)
En 1908, le Congo devient belge
L’État indépendant du Congo (EIC) devient officiellement belge le 15 novembre 1908 en vertu d’une Charte coloniale approuvée par le Parlement. Celle-ci modifie profondément son organisation politique suite aux nombreuses critiques sur les atrocités commises dans les exploitations caoutchoutières. Le Roi Léopold II abandonne son projet personnel de colonisation après de longues discussions avec le gouvernement belge qui n’est pas entièrement favorable à cette reprise. Mais comment en est-on arrivé à cette cession ?
La conquête spatiale
Peu de temps après la fin de la Seconde Guerre mondiale, deux blocs se forment. D’un côté, on retrouve les États-Unis et les pays de l’Europe de l’Ouest, de l’autre, l’URSS et ses alliés communistes. Si les plus grands belligérants évitent l’affrontement direct, une tension vive entre l’est et l’ouest marque l’ensemble de cette deuxième moitié du XXesiècle, chacun essayant de montrer la supériorité de son idéologie, de son modèle économique et de son régime politique sur l'autre. Les répercussions se feront sentir dans de nombreux domaines, aussi bien économique, que militaire, culturel et scientifique.
La compétition se joue également dans la conquête…
La compétition se joue également dans la conquête…
La seconde vague féministe en Belgique (1965-1980)
Beaucoup pensent que l’acquisition du droit de vote des femmes en 1948 met un terme aux revendications féministes. Pourtant, cette avancée bien que majeure constitue une condition nécessaire mais non suffisante à l’émancipation des femmes. C’est pour cette raison qu’elles ont continué la lutte pour une plus grande liberté après 1948 et poursuivent toujours leurs combats actuellement. Ce module est centré sur la seconde vague féministe et prend comme point de départ la grève de la FN Herstal de 1966.
La seconde vague féministe a profondément marqué la société belge.Àla différence du premier mouvement, le néo-féminisme revendique la libération de la femme et non…
La seconde vague féministe a profondément marqué la société belge.Àla différence du premier mouvement, le néo-féminisme revendique la libération de la femme et non…
La Stasi en Belgique
La Guerre Froide, qui s'installe entre les blocs de l'Est et de l'Ouest à la sortie de la Seconde guerre mondiale, voit le développement de services de renseignements plus ou moins élaborés dans de nombreux pays. Parmi ces services, la Stasi mise en place par la République démocratique allemande (RDA) est reconnue comme un des services d'espionnage les plus ramifiés et efficaces de son époque. Son réseau s'oriente vers la République fédérale allemande (RFA) et l'Europe de l'Ouest. Il parvient à infiltrer des agents dans diverses institutions internationales, dont l'Otan à Bruxelles. Les renseignements collectés sont transmis aux autorités politiques est-allemandes et aux…
La vie quotidienne durant l'occupation allemande en Belgique (1940 - 1945)
Le 28 mai 1940, le roi Léopold III annonce la capitulation de la Belgique face à l’armée allemande. Celle-ci s’installe alors sur le territoire en imposant son autorité sur la population: c’est l’occupation. Une administration allemande se met rapidement en place. Elle contrôle tous les aspects de la société : l’alimentation, le travail, les déplacements, etc. Les Belges vivent dans un climat de peur, subissant tour à tour les mesures et répressions menées par l’occupant mais aussi les nombreux bombardements secouant le pays. Durant cinq ans, la population va vivre une situation de guerre bien particulière.
Le travail des enfants en Belgique
Au XIXe siècle,le recours aux enfants comme main-d’œuvre constitue la norme dans beaucoup d'industries.La Belgique est loin d'être un cas unique, au contraire. Ce phénomène transnational, présent dans de nombreux pays industrialisés, est le produit d'une évolution négative du monde du travail. Cependant, un abandon progressif du travail des enfants se remarque. Ainsi, au tournant du XXe siècle, une série de lois sont promulguées afin de limiter l'usage de la main-d'oeuvre enfantine. Elles réglementent l'âge d'admission des enfants au travail et instaurent l'instruction obligatoire dans les différentes industries.
Une groupe d'enfants travaillant dans les…
Les colonies belges à l'Exposition internationale et universelle de 1958
Les Expositions internationales et universelles sont, depuis 1851, des événements mondiaux rassemblant les pays du monde et ouverts au grand public. Véritable vitrine technologique et industrielle, les différentes nations y exposent leurs progrès économiques, industriels, politiques, sociaux et culturels.
À l'occasion de l'édition de 1958 qui se tient à Bruxelles, la Belgique y voit une occasion rêvée de présenter les avancées faites au Congo depuis la Commission d’enquête internationale de 1905 sur les exactions commises dans l'État indépendant du Congo. Deux ans avant que le Congo n'obtienne son indépendance, quel « Bilan pour un monde plus humain » peut-on tirer ?