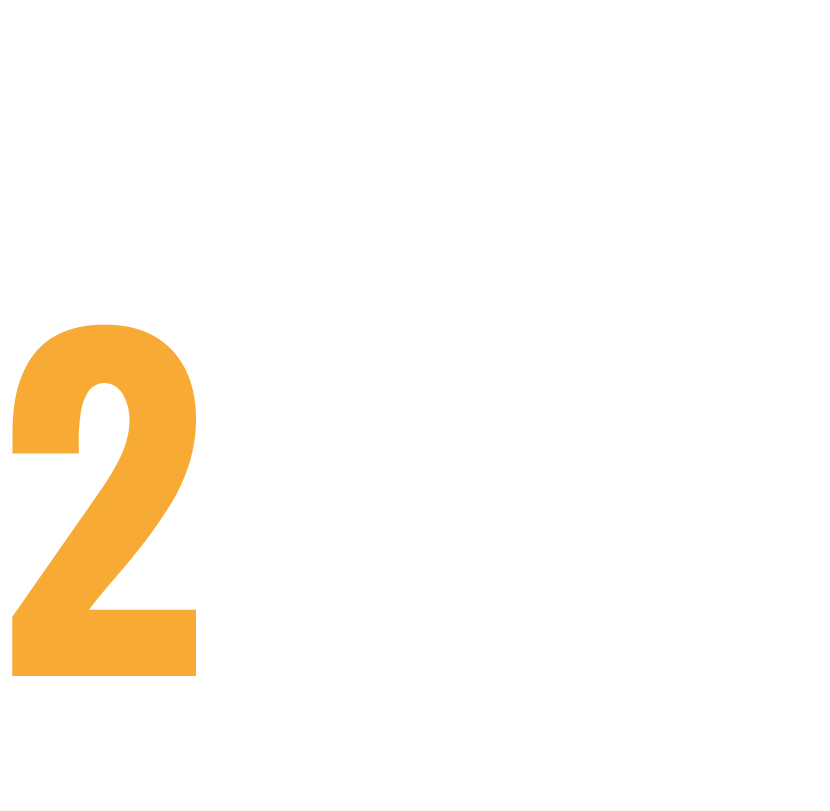Lutte sanitaire
La lutte sanitaire
-
Médecine
En plus des prières et des processions, les contemporains tentent de se guérir via différents antidotes et remèdes préparés par les médecins. Ceux-ci sont désemparés et n’ont pas les connaissances suffisantes pour fabriquer un traitement capable de venir à bout de la peste. Cependant, la peur de mourir était tellement forte que de nombreuses personnes se sont tournés vers ces remèdes comme secours et ce même sans avoir la certitude de leur efficacité.
En plus des médicaments, mixtures et autres potions, les médecins et les barbiers pratiquent aussi des saignées pour purifier le sang des malades. Cette technique, connue et pratiquée depuis l'Antiquité, occupe une place prépondérante aux XVIe et XVIIe siècles. Elle consiste à évacuer une certaine quantité de sang d'un malade afin d'améliorer son état.

Corbeaux emportant les corps des personnes décédées de la peste. Ils fument la pipe pour se protéger des miasmes
-
Recruter du personnel
Dès le XVIe siècle, les autorités recrutent du personnel spécialisé avant les épidémies de peste afin de gérer au mieux la situation lorsque la maladie prend de l’ampleur. On peut citer les gardes, les porteurs de malades, les médecins, les chirurgiens, les apothicaires, les infirmiers, les sages-femmes, les prêtres ou encore les bureaux ou capitaines de santé.
Les gardes sont là pour empêcher les débordements dus à la peste comme les violences faites à l’égard de ceux que l’on suspecte de propager le mal : les juifs, les lépreux, les pèlerins, les voyageurs, les bohémiens et autres boucs émissaires. Ils sont aussi là pour lutter contre le pillage des maisons laissées vides, faire respecter les règlements d’hygiène publique comme le nettoyage, la désinfection ou encore la quarantaine.
Les porteurs de malades et de morts sont parfois volontaires mais c’est très rare, le plus souvent ce sont des gens qui se font payer à prix d’or ou des personnes sur qui on peut exercer un moyen de pression. On les appelle souvent les « corbeaux ». Lorsque les ravages sont trop importants, on recourt à la main-d’œuvre forcée. Les corbeaux sont soumis à certaines règles : ils doivent être isolés de la population, porter un signe distinctif sur leurs vêtements ou un uniforme et effectuer une longue quarantaine à la campagne après une épidémie.

Costume d'un médecin de la peste typique au XVIIe siècle. Le masque est en forme de bec car le médecin y placait des herbes odoréfiantes afin de ne pas être contaminé par les miasmes. Il est munit d'un bâton pour ne pas toucher les malades
Les médecins, chirurgiens, apothicaires, infirmiers et les sages-femmes sont en première ligne et sont donc très souvent victimes de la peste. Les autorités menacent les médecins de ne plus pouvoir exercer après l’épidémie s’ils refusent de soigner les malades. Pour forcer la main, les salaires sont élevés et on promet aux personnes qui acceptent de travailler dans ces conditions différents titres et avantages. Malheureusement, certains volontaires sont attirés par l’appât du gain, se disent médecins alors qu’ils n’ont pas assez de connaissances et parfois même aucune. Le personnel infirmier est plus aisé à trouver car on peut compter sur les religieux et religieuses. Le recrutement de prêtres pour assister les malades devient fréquent à partir du XVe siècle.
Les bureaux de santé et capitaines de santé, mis en place dès le XIVe siècle, sont une sorte de conseil restreint chargé de proposer à l’échelle d’une ville, d’une région toutes les mesures à prendre pour lutter contre la maladie. Dès le XVe siècle, ces personnes sont aussi désignées pour surveiller l’exécution des mesures. Ces conseils peuvent donc décider et agir, ils ont des pouvoirs dictatoriaux. Soit ce pouvoir est confié à un groupe, un bureau de santé, ou à une seule personne, un capitaine de santé.
-
Mesures de prévoyance et d’entraide
Le problème de la nourriture se pose très vite suite à l’isolement et à la fuite d’une partie de la population. Les villes coupent les contacts avec les lieux infectés et la situation devient parfois dramatique sans approvisionnement extérieur. Cette situation pousse les autorités à gérer le ravitaillement. Ainsi, à partir du XVIe siècle, dès que les autorités apprennent que la peste arrive, elles achètent du blé en masse et constituent des réserves de vivres. C’est primordial car il s’agissait de veiller aux stocks pour pourvoir non seulement aux besoins des malades et habitants mais aussi à ceux des nombreux mendiants, pauvres et orphelins afin d’éviter que ces derniers fuient la ville et propagent la maladie.