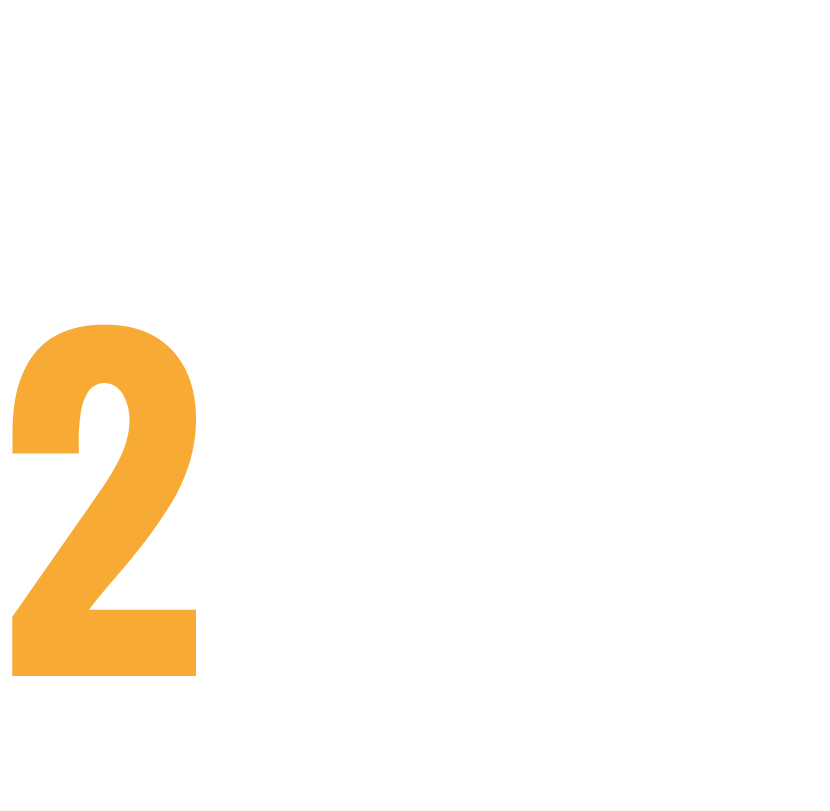La fin des épidémies dans nos régions au XVIIe siècle
Certes les contemporains du XVIIe siècle n’avaient pas encore trouvé les véritables causes de la maladie, mais celle-ci a bel et bien reculé à un moment. Or la « disparition » de la peste pose différents problèmes, car encore à l’heure actuelle, ni les épidémiologistes, ni les historiens n'ont d'explications définitives quant à ce recul dans nos régions à la fin du XVIIe siècle.
Les mesures prises aux XIVe et XVe siècles pour lutter contre la maladie sont rares, souvent isolées et n’ont donc pas de portée réelle à l’exception faite des actions humanitaires organisées par les institutions chrétiennes pratiquant la charité, que les autorités civiles reprennent et élargissent par la suite. Dès la fin du XVe siècle et le début du XVIe siècle, les mesures se multiplient, s’accumulent, se coordonnent et se codifient peu à peu.
Certaines théories développées lors de cette période, qu’elles soient avérées ou erronées, poussent les autorités à prendre certaines décisions, parfois bénéfiques. Par exemple, La théorie contagionniste permet de systématiser l’isolement. Elle permet aussi aux autorités de légiférer sur la limitation des déplacements des populations, afin d'éviter la propagation de la peste. On assiste à la mise en place des bureaux et des capitaines de santé qui prennent des mesures drastiques pour faire respecter les règlements, hospitaliser les malades ou les placer en quarantaine. Il faut également noter le développement des désinfectants, les progrès de l’hygiène publique et de la salubrité des villes.
Au XVIIe siècle, la mise en place d’un réseau international d’informations sanitaires, avec les billets/passeports de santé, jointe à la participation active des gouvernements contribuent au recul de la maladie, permettant, sauf quelques poussées locales et temporaires, de la faire progressivement disparaître du continent européen après trois siècles de présence. C’est cette coordination des efforts de la part des autorités disposant de moyens matériels et financiers sur de vastes territoires, ainsi que l’application de plus en plus rependue de la quarantaine qui sont les éléments fondamentaux du recul de la peste. Il faut aussi noter qu’au XVIIIe siècle, les rats noirs sont chassés des villes puis des campagnes par les rats bruns. Cela pourrait expliquer, en partie, la fin des épidémies, la maladie étant principalement transmise par les rats noirs plus sensibles au bacille de Yersin que les rats bruns.
C’est en 1894 que le germe de la maladie est finalement découvert et décrit pour la première fois. Jusque dans les années 1920, on considère que le rat est le seul responsable des épidémies de peste, le seul vecteur de diffusion par le biais de leurs puces. Or, peu à peu, les chercheurs et médecins reviennent sur cette théorie. La peste se propage en effet principalement via les voies de communication et cette pandémie s’explique également par une transmission d’humain à humain. Cette théorie se renforce peu à peu et les scientifiques accordent un rôle de plus en plus important aux relations interhumaines, même si le rat reste une cause principale de la diffusion de la peste. De plus, ce dernier n’est en réalité pas le seul rongeur vecteur de la maladie. Ricardo Jorge découvre en 1925 que d’autres rongeurs sauvages peuvent aussi être infectés.
Même si nous connaissons aujourd’hui les causes de cette maladie, elle n’a pas disparu pour autant. En septembre 2017, une épidémie de peste s’est déclarée à Madagascar, emportant 24 personnes en l’espace d’un mois. Depuis 1980, la maladie réapparaît presque chaque année dans le pays.