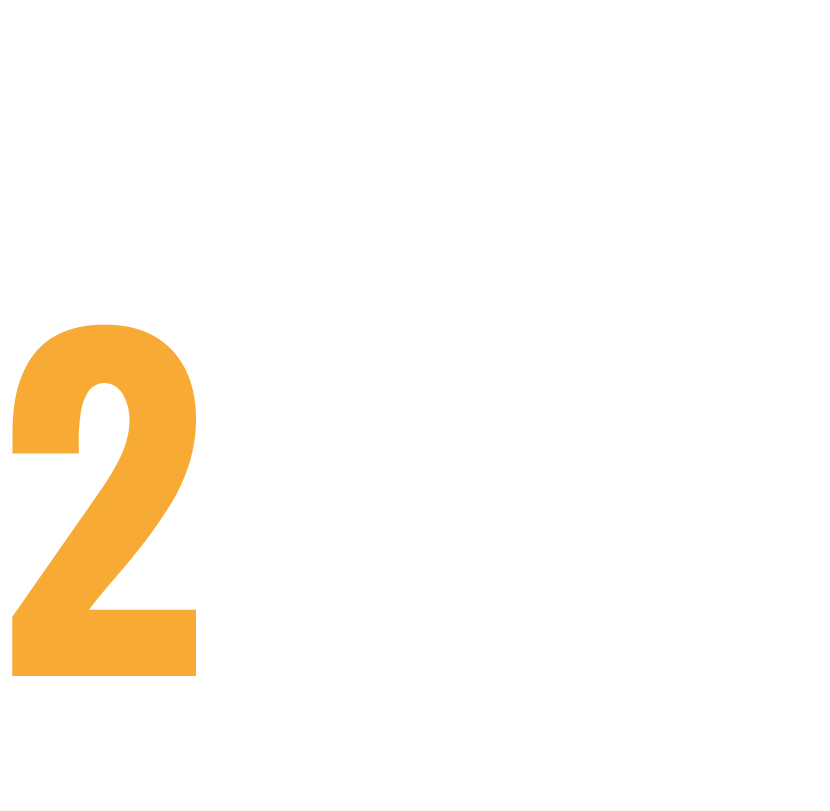Dispositions réglementaires
Les dispositions réglementaires
-
S'informer et informer
Dès le XIVe siècle, les autorités prennent des mesures afin de recueillir différentes informations quantitatives importantes. Elles veulent notamment connaître le nombre de victimes de la peste, autrement dit les malades, les morts, les suspects mis en quarantaine et les pauvres réduits à la misère suite au chômage. Dès la Peste Noire, les gouvernants réclament de plus en plus de recensements de population mais aussi l’enregistrement des décès, chose qui n’était pas faite systématiquement auparavant.
Au XVIe siècle des délégations (un médecin, un chirurgien, deux magistrats) sont chargées d’enquêter afin de savoir si la peste est de retour ou s'il ne s’agit pas d’une autre maladie ou de rumeurs. Ils doivent ensuite immédiatement faire rapport de leur constat aux autorités.
Ne pas faire entrer la maladie dans un lieu sain est une chose primordiale. Les navires et les voyageurs souhaitant entrer dans une ville sont dès lors contrôlés grâce aux patentes pour les navires, et aux billets de santé pour les voyageurs. Lorsque les navires sont sains, ils reçoivent une patente blanche, dans le cas contraire, ils en reçoivent une brune. La patente doit être montrée lorsque le bateau arrive au port. Si elle est brune, le navire est refoulé ou mis en quarantaine. Cette méthode est mise en place à Venise en 1377 ; les marins arrivant par bateaux devaient rester 40 jours à bord avant de pouvoir se rendre en ville. Cette méthode est ensuite utilisée dans toute l’Europe. Les billets de santé, mis en place au XVe siècle, sont des passeports sanitaires individuels fermés par une petite bulle et délivrés à tout voyageur sortant d’une ville afin que celui-ci puisse garantir qu’il vient d’un lieu non infecté. Ce billet est demandé aux portes de toutes les villes et villages avant d’autoriser ou non l’entrée du voyageur. L’usage de cette technique ne se généralise qu’au XVIIe siècle. Bien entendu dans les deux cas, ces documents sont parfois falsifiés.
Dès les premières épidémies, les autorités mettent en place des règlements de peste, autrement dit des mesures à appliquer pour éviter la propagation de la maladie. Ainsi, certaines universités ferment leurs portes, les pestiférés sont dans l'interdiction d’entrer dans les églises, le sang des saignées faites aux pestiférés doit être jeté hors de la ville, il est interdit de toucher ou vendre des objets appartenant à des malades et les maisons infectées doivent être fermées pendant plusieurs semaines. Dans un premier temps, les villes s’empruntent des mesures les unes aux autres, puis une réglementation plus globale se met en place au XVIe siècle. Ces règlements sont de plus en plus complets au fur et à mesure des nouvelles épidémies. Au XVIIe siècle, ils sont renforcés : chacun doit nettoyer sa maison, les ordures doivent être portées en dehors de la ville, les maisons infectées doivent être marquées, les malades doivent être reconnaissables dans la rue, des médecins, chirurgiens et pharmaciens sont affectés aux soins des pestiférés, on expulse parfois de la ville certains malades, on brûle le mobilier et les vêtements des malades, parfois leur maison, on met des gardes aux portes, etc. Peu à peu, la lutte contre l’épidémie prend une nouvelle dimension, les mesures ne sont plus seulement locales, mais provinciales et même nationales et ce principalement au XVIIe siècle.
-
Isoler : les lieux, les morts, les malades
Comme nous l’avons vu, les populations pensent que l’air est infecté et donc tentent de fuir les lieux contaminés. Cependant dès le XVIe siècle, les gens prennent de plus en plus conscience que la fuite est l’une des principales causes de diffusion de la maladie et de plus en plus de mesures sont prises pour empêcher les gens de partir. À partir du XVIIe siècle, les individus prennent conscience que l’air n’est infecté que près des malades et des morts et qu’il suffit de s’en éloigner pour éviter de tomber malade. Ces mesures servent également à empêcher les personnes de se déplacer entre différents lieux, ici aussi pour éviter toute propagation.
Autre préoccupation : les morts. En effet, face au haut taux de mortalité de l’épidémie, les autorités sont très vite confrontées aux difficultés liées à l’évacuation et l’enterrement des cadavres. Les cimetières étant généralement pleins, on enterre les corps dans les jardins, on les entasse dans des fosses ou on s’en débarrasse en mer quand cela est possible. Peu à peu, les magistrats font construire de nouveaux cimetières et interdisent l’enterrement dans et autour des églises. Cette mesure, pourtant nécessaire à la salubrité des villes, est très mal accueillie, car elle se heurte au désir des fidèles de reposer près de Dieu, mais aussi car être enterré en terre sainte permet d’éviter les profanations des tombes. Les corps sont dès lors de plus en plus souvent inhumés dans des champs éloignés des villes et habitations, ou jetés dans les fleuves.
Plus encore que les morts, le contact avec les malades est particulièrement redouté et on cherche à les isoler par tous les moyens. La méthode la plus ancienne est d’isoler les pestiférés en les enfermant dans leurs maisons. Au XVIe et XVIIe siècles, cette mesure est quelque peu adoucie et devient un privilège des plus riches qui peuvent se faire soigner chez eux, alors que les plus pauvres, eux, sont obligatoirement envoyés dans les hôpitaux. Une autre mesure prise est l’expulsion des malades de la ville ou du village. Principalement appliqué au XVe et au début du XVIe siècle, il ne le sera plus par la suite car on prend conscience qu’agir de la sorte propage la maladie. Dès lors les malades, lorsqu’ils peuvent sortir, doivent porter un signe distinctif et il est interdit aux gens de les approcher. Peu à peu, ces méthodes d’isolement vont s’accompagner de soins. On isole de plus en plus les pestiférés dans des hôpitaux spécialisés, ce qui permet d’exercer une surveillance collective et de dispenser les soins plus aisément. Malgré les efforts pour garder ces bâtiments les plus salubres possible, en temps d’épidémie, ceux-ci sont souvent surencombrés par l’afflux de malades, empestés par le manque d’oxygène et les cadavres que le personnel, débordé, ne sait plus évacuer. La mise en quarantaine des pestiférés est le meilleur moyen pour éviter la propagation de la maladie ou la contamination d'un lieu sain. Pratiquée depuis le XIVe siècle, cette alternative est encore utilisée de nos jours.

Cette scène a lieu dans la ville de Rome en 1656. Des meubles et autres objets d'une maison infectée sont lancés par la fenêtre et brûlés
-
Nettoyer et purifier
Le nettoyage et la désinfection des rues deviennent rapidement une priorité en cas d’épidémies car les immondices qui les encombrent sont suspectées de répandre la maladie. Il est dès lors interdit de déposer des ordures dans les rues, de tanner les peaux à l’intérieur de la ville, de jeter dans la rue le sang des saignées ou de le donner aux cochons pour les engraisser. Dans les villes, les animaux sont interdits, tandis que les fumiers et ordures doivent être enlevés et jetés dans des endroits particuliers.
L’eau est réputée pour purifier, presque autant que le feu. Lors de plusieurs épidémies de peste aux XVIe et XVIIe siècles, des canaux en bois ou en pierre sont construits afin de dévier l’eau dans les rues pour les nettoyer et les désinfecter. Certaines artères sont dès lors pavées afin de faciliter cette opération.
Le feu est l’un des plus anciens moyens utilisés pour lutter contre la peste. Au Moyen Âge on brûle les maisons infectées et parfois des quartiers entiers. C’est beaucoup plus rare au XVIIe siècle. En revanche le mobilier et les vêtements des pestiférés sont détruits par le feu, rarement désinfectés.

Corbeaux enterrant les corps des personnes mortes de la peste dans un champ. Ils fument du tabac pour se protéger des miasmes
La désinfection débute aux XIVe et XVe siècles et se fait par des parfums ou en brûlant des bois odoriférants. Au XVIIe siècle, le soufre, la poudre à canon et le vinaigre commencent à être utilisés. La désinfection est pratiquée par des personnes spécialisées, généralement appelées les parfumeurs ou les désinfecteurs. Les maisons des pestiférés sont nettoyées, les ordures et les pailles des lits sont brûlées, les meubles enlevés et des petits tas de paille sont disposés dans chaque pièce et recouverts de parfum avant d'être brulés. Les habitants peuvent revenir après plusieurs heures.
Dans leurs masques, les médecins mettent des herbes parfumées pour lutter contre les miasmes, ce qui explique leur forme en bec d’oiseaux. Une plante odoriférante particulièrement appréciée est le tabac, sa fumée est recommandée par les médecins comme purifiant de l’air. Dès lors, l’Europe entière se met à fumer dès le XVIIe siècle à chaque fois qu’une épidémie de peste se déclare.