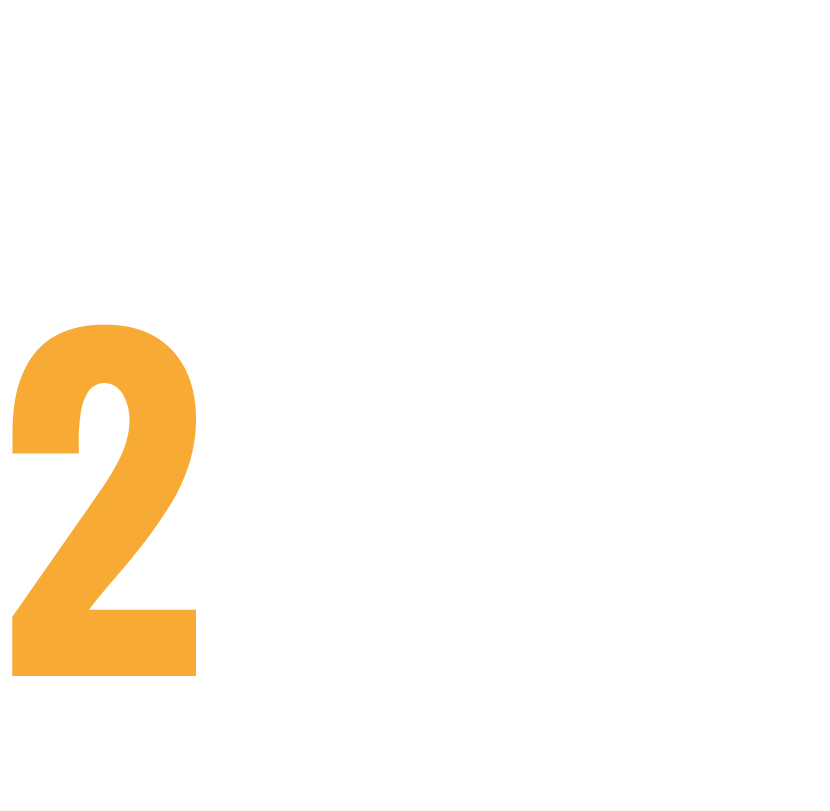À la recherche des causes
Les contemporains sont à l’époque dans l’incertitude totale. Ils cherchent diverses explications afin d’une part, de lutter contre la maladie et d’autre part, de se rassurer quant à ce fléau inconnu, dont personne ne semble savoir ni les origines ni les manières d’en sortir.nbsp;
Colère divine et êtres surnaturels
Dès l’antiquité, les épidémies sont vues comme des vengeances ou des châtiments de la part des dieux. Le christianisme, dans les siècles suivants, transmet lui aussi cette idée de la colère divine envers les hommes qui auraient mal agi. Au XVIIe siècle, cette conviction est encore très ancrée dans les mœurs.
En plus du châtiment divin, les contemporains expliquent également l’origine des épidémies par l’interférence d’êtres surnaturels sur terre. Ces derniers peuvent alors prendre des formes diverses : celle du mauvais ange, du génie, du fantôme de la peste décrit comme un homme aux longues jambes et au manteau rouge, de la vieille femme vêtue de noir, voûtée et gémissante, appelée « la mère Peste » ; ou encore celle du diable vêtu de noir qui graisse les portes et les fenêtres d’un onguent pestiféré.
Personnes malveillantes
En période d'épidémie, les communautés s'en prennent régulièrement à des "boucs émissaires", appartenant à des populations marginalisées et stigmatisées, accusées de provoquer et répandre le fléau par malveillance.
Lors de la peste noire, ce sont principalement les juifs et les lépreux qui sont montrés du doigt. Au XVIIe siècle, les juifs continuent d'être source de méfiance. Se joignent à eux les Tartares, accusés d’empoisonner les sources, mais aussi les bohémiens, les voyageurs, les pèlerins et tous autres groupes de nomades, eux aussi suspectés de répandre la peste partout où ils passent.
Infection de l’air et contagion
Au XVIIe siècle, trois théories sont mises en avant pour expliquer comment la maladie se transmet d’une personne à une autre.
La théorie "aériste" est la cause la plus fréquemment invoquée. Formulée dès l'Antiquité, elle repose sur l’empoisonnement de l’air, un air vicié, qui transmettrait la maladie. Cependant, personne ne sait exactement ce qui cause cette corruption de l’air ni comment elle agit sur le corps. Par conséquent, on accuse l’air chaud et humide de « se putrifier » plus facilement. L’haleine des malades, les corps non enterrés, les humeurs putrides éjectées sous forme de vapeurs par le corps des malades et qui infecteraient ensuite l’air sont incriminés. Les gens remarquent également que les vêtements des pestiférés peuvent transmettre la maladie et pensent que c’est à cause de l’air vicié retenu dans les tissus.
Cette pensée s’inscrit dans la théorie miasmatique, principale théorie en matière de contagion jusqu’au XIXe siècle. Les miasmes seraient des émanations causant les maladies comme la peste ou le choléra. Ils seraient présents sous forme de vapeur, brouillard ou gaz putrides, rempli de particules provenant de substances en décomposition. Ces miasmes sont liés à la puanteur, si l’air sent mauvais, c’est qu’il est infecté. C’est pour cette raison que les médecins mettaient des herbes odoriférantes dans leurs masques. Selon eux, ces miasmes se trouvent dans l’air mais aussi dans l’eau et la nourriture. Cette théorie perdure jusqu'au XIXe siècle, époque à laquelle on découvre les microbes et leur rôle dans les maladies (la théorie microbienne).
On pense également que la peste peut se propager par les animaux, surtout les animaux domestiques qui eux aussi meurent de la maladie. On accuse les porcs, les oies, les cannes, les chiens, les souris, les punaises et autres animaux de propager la maladie par leurs déjections. Pourtant, parmi la liste des accusés, on ne retrouve ni les rats, ni les puces, tous deux vecteurs de transmissions. Cette idée que la peste se transmet par les animaux et que l’air n’est pas le seul à la diffuser prend peu à peu de l’importance au XVIe siècle. C'est ce qu'on appelle la théorie « contagionniste ».
Toutefois, les théories « aériste » et « contagionniste » coexistent au sein de la population qui, dans la peur et l'incertitude, ne sait pas toujours laquelle croire.