La rencontre européenne avec le Nouveau Monde au XVIe siècle
Les "grandes découvertes", un concept à interroger
Précisons que tout au long de ce parcours certains termes utilisés doivent être nuancés. C’est le cas, par exemple, du qualificatif "découverte" souvent utilisé pour désigner la rencontre de Christophe Colomb avec le continent américain et du vocable "Indien" pour nommer ses habitants. Ces termes sont aujourd'hui remis en pespective puisqu'ils renvoient à des représentations partielles des évènements reposant exclusivement sur le point de vue des colons européens et non des populations locales. C'est ce que les chercheurs appellent l'européocentrisme.
Par exemple, pour les Européens, l'emploi du mot "découverte" a une certaine cohérence puisque le continent américain leur était jusqu'alors inconnu et représentait en ce sens une réelle découverte. Toutefois, cet espace était déjà habité depuis bien longtemps et la présence de nombreux peuples indigènes en est la preuve la plus évidente (comme les peuples précolombiens à l'instar des Aztèques, Mayas, Incas, etc.). Par conséquent, l'arrivée des Espagnols à partir de 1492 ne constitue pas une vraie découverte au sens propre du terme mais plutôt une rencontre entre des peuples qui s'ignoraient. A l'heure actuelle, le terme "découverte" aurait été plus approprié si les Espagnols étaient arrivés sur une terre inhabitée et encore inconnue.
Le raisonnement est similaire pour le terme "Indien". Il est un qualificatif généralisant utilisé par les colons espagnols pour désigner des populations autochtones extra-européennes. Ce vocable ne reflète pas la diversité des ethnies sur place et n'a pas de sens autoréférentiel pour les premiers habitants. Autrement dit, un Aztèque ne se définit pas en tant qu' "Indien", désignation européenne, mais en fonction du groupe social et culturel auquel il appartient (Nahua, par exemple). Dès lors, nous mettrons dans ce parcours le terme "Indien" entre guillemets afin de montrer que cette appélation est datée et située puisque tirée de sources europénnes du XVIe siècle.
Dès lors, que faut-il en retenir ? Il est important de garder à l'esprit l'existence et l’importance d'une pluralité des points de vue à aborder. La manière par laquelle sont construits certains de nos récits historiques, comme la "découverte du Nouveau Monde", sont le reflet d'une vision européocentrée, partielle et subjective des évènements dont on peine encore à se défaire. Il n’existe donc pas un point de vue européen unique sur ce sujet mais plusieurs conceptions qui doivent sans cesse être confrontées et interrogées.
Rendre possible la "découverte"
Plusieurs éléments peuvent expliquer le projet de Christophe Colomb et sa rencontre imprévue avec le continent américain en 1492 : la recherche de nouvelles routes commerciales, des avancées techniques et un contexte politique favorable à l'expédition.
La situation géographique de l'Europe fait qu'elle est freinée dans son commerce avec l'Orient en raison de la présence, à l'Est, de l’Empire ottoman. Ce dernier forme en effet un passage obligé entre l'Europe et l’Asie lui permettant de taxer les marchandises, en particulier les épices, qui circulent sur son territoire. Pour contrer ce voisin, désireux de s’enrichir, l’Occident cherche d’autres routes de commerce vers l’Asie et plus spécifiquement vers les Indes. La recherche de nouvelles routes est rendue possible par plusieurs avancées techniques. Avant le milieu du XVe siècle, les marins européens ne savent pas naviguer en haute mer. En 1430, la mise au point de la caravelle par les ingénieurs portugais change la situation. Il s’agit d’un bateau léger, proche d'un bateau d'exploration, qui permet aussi bien de naviguer en haute mer que de longer les côtes et de remonter les fleuves. En outre, la création de nouveaux instruments de navigation permet aux marins de mieux se repérer par rapport à la position du soleil et des étoiles. Il s’agit par exemple du gouvernail d'étambot, de la boussole et de l’astrolabe. Enfin, la mise au point de la cartographie et, plus particulièrement, du portulan complète ces progrès technologiques.
Les Ottomans limitent non seulement l’approvisionnement des Européens en épices, mais également en or. En effet, les mines européennes ne savent plus répondre à la demande en métaux précieux. Par conséquence, ce sont les mines africaines, alors les plus importantes connues à l’époque, qui alimentent en or et en argent les pays européens. Cependant, ces métaux ne parviennent sur le continent qu’en faible quantité et au compte-gouttes à cause du troca muda, c’est-à-dire un monopole détenu par les marchands magrébins. En raison de ces contraintes, l’objectif des Européens est de contourner ces intermédiaires pour obtenir de l'or par eux-mêmes. La quête de ce métal précieux est leur principal mobile. Les Portugais, sous l’initiative du prince Henri d'Aviz, sont les premiers à imaginer une alternative en contournant le continent africain. Leurs expéditions successives les conduisent le long de la côte ouest-africaine. Ils y fondent des comptoirs commerciaux. En 1455, ils atteignent le Cap-Vert. Puis en 1487, Barholomé Diaz franchit le cap des tempêtes au sud du continent africain. Il sera renommé par la suite le Cap de Bonne-Espérance. Une nouvelle route vers l’Asie est tracée…
Une trouvaille inattendue
Christophe Colomb atteint le "Nouveau Monde" par hasard. Ce marin génois, né autour de 1451, navigue dès sa tendre jeunesse. Grâce à ses compétences, il travaille pour la couronne portugaise pendant plus de huit ans, mais effectue aussi différents voyages pour son intérêt personnel qui l’amènent même jusqu'en Islande en 1477. Ses voyages sont animés par la volonté de traverser l’Atlantique pour rejoindre les Indes. Dans l’imaginaire et les savoirs européens de l’époque, les Indes représentent l’Extrême-Orient. Il tente à deux reprises de convaincre le roi Jean II de Portugal de financer son voyage vers l’Atlantique, mais son idée, ses calculs et ses études ne séduisent pas suffisamment le souverain. Christophe Colomb essuie alors deux refus consécutifs.
Non loin de se décourager, il décide de tenter sa chance en Espagne. La fin de la "Reconquista" en 1492 lui permet d’obtenir le financement tant recherché. En effet, le dernier bastion musulman de la Péninsule ibérique, Grenade, tombe aux mains des « Rois Catholiques », Isabelle de Castile et Ferdinand d’Aragon. Cette victoire leur laisse la possibilité d’écouter et d’approuver le projet de Christophe Colomb dont la proposition s’insère bien dans le programme politique des souverains de conquête et d’évangélisation de nouveaux territoires. Les 17 et 30 avril 1492, la signature des Capitulations de Santa Fé fixe les conditions de l’expédition.
Le 3 août 1492, Christophe Colomb embarque pour son premier voyage avec trois caravelles (la Pinta, la Niña et la Santa Maria) et 90 hommes. Il arrive le 12 octobre aux îles Bahamas. Il croit avoir accosté à l’est de l’Asie. En conséquence, les habitants des territoires sont tout de suite appelés les "Indiens". Son exploration jusqu’à l’île de Cuba dure deux semaines. Avant de repartir pour l’Europe, il laisse un groupe de compagnons sur l’actuelle île d’Haïti qu'il nomme « Hispaniola ». À son retour, il est reçu triomphalement même s’il rapporte peu d’or et peu de coton dans les cales de ses navires.
À peine de retour, Christophe Colomb se lance dans une seconde expédition entre 1493 et 1494 qui lui permet de mettre la main sur de nouvelles ressources minières et de nouveaux territoires. Les Espagnols qui conquièrent ces régions sont appelés, au XVIe siècle des conquistadors. Christophe Colomb entreprend la colonisation d'Hispaniola, il essaie de peupler l'île d'hommes et de femmes venus d'Europe. Ces derniers sont appelés "colons". Cependant, cette opération s’avère difficile à cause de nombreux conflits avec les populations de l'île. Aussi, en débarquant sur de nouvelles îles, les actuelles « Petites Antilles », les Européens sont rapidement confrontés à des peuples anthropophages. En 1494 (l’année du retour de Colomb en Espagne), le pape Alexandre VI délimite les zones d’influence des Portugais et des Espagnols par le traité de Tordesillas qui fixe une ligne de partage imaginaire à 200 kilomètres du Cap-Vert. Ce faisant, les Portugais obtiennent l’Est et les Espagnols l’Ouest. Quatre ans après, une nouvelle mission est confiée à Christophe Colomb. Il embarque avec 330 colons vers les Indes occidentales. Il s'agit du nom donné aux Amériques jusqu'en 1507. À leur arrivée, ils font face à une rébellion des colons déjà installés sur place, déçus de ne pas avoir pu s’enrichir. En 1500, à l’issue de ce troisième voyage, Christophe Colomb est arrêté par l’enquêteur royal, Bodadilla pour mauvaise gestion des colonies. Il est ramené enchainé en Espagne et destitué de son titre de gouverneur des Indes. Il est également accusé de ne pas avoir découvert la vraie route vers les Indes.
Si la troisième expédition poursuit clairement un objectif de colonisation, le but de la dernière est différent : c'est la découverte. En 1502, les Rois Catholiques demandent à Christophe Colomb d’atteindre l’Asie en passant par l’Atlantique. Les souverains ne veulent pas perdre l’avantage face aux Portugais qui, de leur côté, avancent à l’Est. En effet, en 1498, Vasco de Gama réussit à rejoindre les Indes orientales par la mer. L'ultime voyage de Christophe Colomb se révèle malheureusement être un échec en raison des mauvaises conditions climatiques et des méconnaissances géographiques de l’époque. Il tentait alors de longer les côtes de l'actuelle Amérique pour rejoindre l’océan Pacifique mais il échoue. Christophe Colomb décède le 20 mai 1506 en ignorant avoir découvert un nouveau continent. Un an après sa mort, Amerigo Vespucci lui donne le nom d’Amérique.
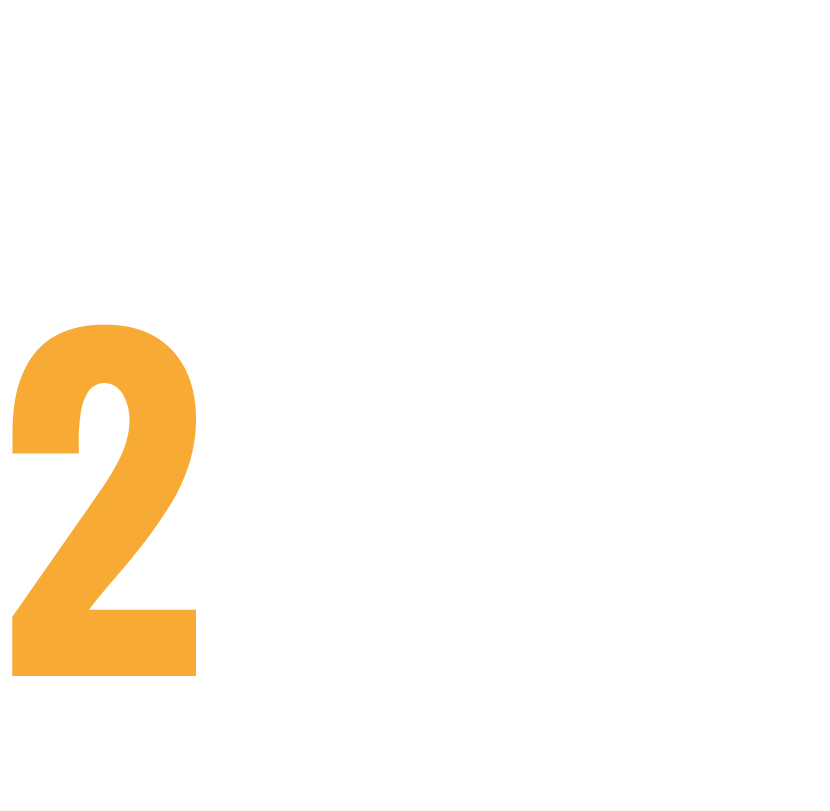
![Atlas de cartes marines, dit [Atlas catalan] Atlas de cartes marines, dit [Atlas catalan]](https://clio2web.uclouvain.be/files/fullsize/3bdaadfac0bd3b41a2080a2c60fe7e6f.jpg)




